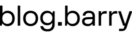Des coupures d'électricité en cascade
Texas : un réseau inadapté aux vagues de froid
Entre impréparation et négligences
Découvrir barry
Un mix énergétique reposant principalement sur le gaz naturel
Un réseau en flux tendu
Le gaz : une bonne moitié du mix électrique texan
Un réseau non-interconnecté avec ses voisins
«Qu’importe le prix payé, le réseau n’était pas en mesure de fournir de l’électricité.»
Un problème de gouvernance énergétique
Un signal envoyé au consommateur
Vers un modèle européen de tarification dynamique de l'électricité
Pour continuer ta lecture
Le radiateur connecté : un must pour réduire ta facture électrique
Un radiateur oui, mais connecté c’est mieux ! En quelques secondes, tu ajustes la température de ton chez toi, pour...
Lire l'articleQuels sont les avantages de la smart home au quotidien ?
La smart home ou maison connectée, est une habitation équipée d’un système qui permet de relier les appareils électroniques entre...
Lire l'articlePeut-on être payé pour consommer de l’électricité ?
Titre aguicheur, n’est-ce pas ? Se faire payer par le réseau pour consommer de l’électricité : une idée saugrenue ?...
Lire l'article